Premier des trois unificateurs du Japon pendant la période Sengoku. Il est élu personnalité historique la plus importante du Japon lors d'une émission de TV diffusé sur Nippon Television.
La Cité aux murs incertains, de Haruki Murakami : critique d’un auteur face à ses propres fantômes
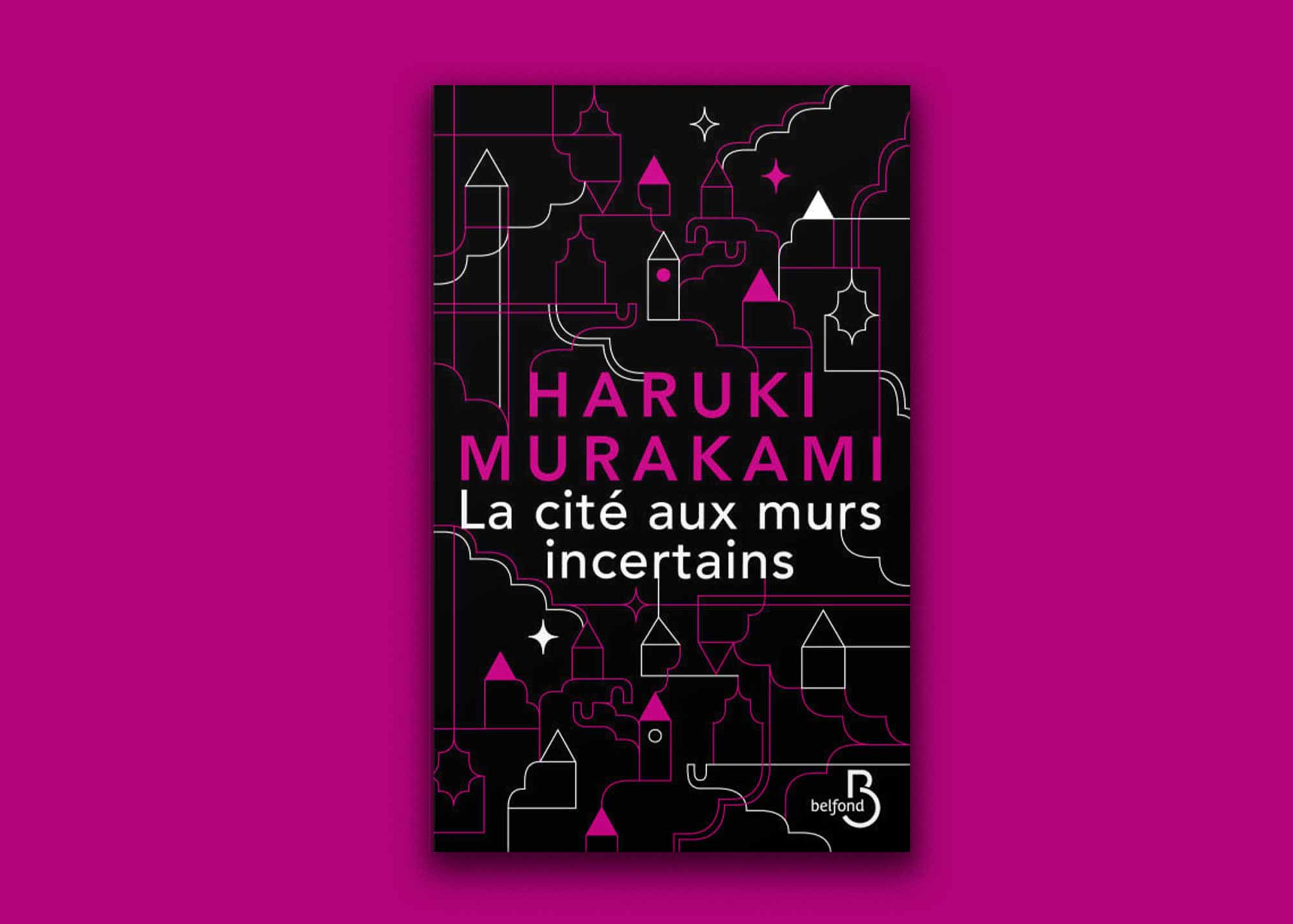
Après sept années d'absence romanesque, Haruki Murakami est revenu avec une œuvre monumentale de plus de 700 pages qui s'impose comme l'un des projets les plus ambitieux et les plus intimes de sa carrière. Ce roman, fruit d'une gestation exceptionnelle de quarante ans, représente bien plus qu'un simple retour : c'est une plongée vertigineuse dans les obsessions fondatrices de l'auteur japonais, une exploration métaphysique des territoires de l'âme où se dissolvent les frontières entre mémoire et oubli, présence et absence, réalité tangible et mondes oniriques.
La parution de La Cité aux murs incertains au printemps 2023 a été un véritable événement littéraire au Japon. Comme à chaque nouvelle sortie de l’écrivain, les librairies ont ouvert à minuit pour accueillir des files de lecteurs impatients. Le roman s’est immédiatement hissé en tête des ventes nationales, confirmant l’aura quasi mythique dont jouit Murakami dans son pays. Dans un paysage éditorial souvent dominé par la littérature jeunesse et quand les librairies japonaises ouvrent à minuit, ce n’est pas pour le dernier manga populaire, mais pour Murakami. Ce succès démontre à quel point Murakami reste une figure culturelle à part, capable de rassembler un public transgénérationnel autour d’un texte exigeant et ambitieux. Et comme à chaque parution, le nom de Murakami revient aussitôt dans les discussions autour du Nobel de littérature, ce prix qui lui échappe encore. La Cité aux murs incertains sonne justement comme une candidature officieuse, testamentaire et pleine de vitalité.
Une odyssée introspective entre rêve et réalité
L'histoire s'articule autour d'un homme hanté par le souvenir de son premier amour adolescent, une jeune femme qui lui parlait d'une ville mystérieuse entourée de hauts murs. Dans cette cité hors du temps, l'entrée exige un prix singulier et irréversible : l'abandon de son ombre, cette part obscure de nous-mêmes qui porte nos souvenirs, nos douleurs, mais aussi notre humanité profonde. Après la disparition soudaine et inexpliquée de cette femme, le protagoniste entreprend une quête qui le mènera aux confins du réel, devenant "liseur de rêves" dans cette ville énigmatique où il déchiffre les songes cristallisés dans des crânes de licornes – image surréaliste typiquement murakamienne qui conjugue poésie et étrangeté.
L'histoire d'une obsession littéraire
La genèse de ce roman mérite qu'on s'y attarde, tant elle éclaire la nature profonde de l'œuvre. En 1980, un jeune Murakami de trente ans esquisse une nouvelle intitulée La Cité et ses Murs Incertains. Insatisfait du résultat, il l'enterre dans ses tiroirs, mais l'image de cette ville refuse de disparaître. Elle resurgit cinq ans plus tard, transformée et amplifiée, dans La Fin des temps (1985), où elle devient l'une des deux trames narratives majeures. Cette première métamorphose ne suffit pourtant pas à épuiser le potentiel de cette vision originelle.
Quarante ans après cette première tentative, Murakami exhume son texte initial pour lui offrir enfin sa forme finale. La Cité aux murs incertains n'est ni une suite, ni une simple réécriture, mais plutôt une cristallisation, l'aboutissement d'une méditation qui aura traversé quatre décennies. Cette maturation exceptionnelle confère au roman une profondeur particulière : chaque page porte la trace de cette longue gestation, comme si l'auteur avait laissé son idée fermenter dans les caves de son inconscient jusqu'à atteindre sa pleine maturité. On ressent dans la texture même du récit cette sédimentation du temps, cette accumulation de strates narratives qui donnent à l'ensemble sa densité… parfois jusqu’à l’excès.
L’architecture narrative en miroir
Murakami déploie ici sa maîtrise de la construction narrative duale, alternant entre deux réalités qui se répondent et s'interpénètrent. D'un côté, le monde contemporain du Japon, avec ses cafés tokyoïtes, ses bibliothèques de province, ses conversations anodines autour d'un café fumant. De l'autre, cette ville aux murs incertains, territoire onirique où le temps semble suspendu, où les règles de la physique ordinaire ne s'appliquent plus, où les licornes errent paisiblement et où les rêves prennent une forme tangible.
Cette structure en miroir n'est pas qu'un artifice formel : elle incarne la dualité fondamentale de notre existence, tiraillée entre le prosaïque et le mystique, entre l'ancrage dans le quotidien et l'aspiration à la transcendance : d’un côté le quotidien simple (cafés, bibliothèques, conversations anodines), de l’autre une quête plus mystique et spirituelle. Le génie de Murakami réside dans sa capacité à faire coexister ces deux dimensions sans jamais les hiérarchiser. Le banal n'est pas moins important que l'extraordinaire ; une conversation dans un café peut receler autant de mystère qu'une traversée des frontières du réel.
La progression narrative épouse un rythme hypnotique, presque musical. Les répétitions, les variations, les leitmotivs reviennent comme des refrains obsédants. Cette lenteur contemplative pourra dérouter les lecteurs habitués aux intrigues plus nerveuses. Mais elle participe pleinement du projet esthétique de l’auteur : créer un état de conscience modifié où le lecteur, comme le protagoniste, se retrouve peu à peu dépossédé de ses repères.
« Ce n’est que lorsqu’on abandonne son ombre qu’on se rend compte qu’elle est nantie d’un certain poids »
La ville aux murs incertains fonctionne comme une métaphore puissante de notre condition contemporaine. Dans un monde où les repères traditionnels s'effritent, où la frontière entre virtuel et réel devient de plus en plus poreuse, où l'identité elle-même devient fluide et multiple, Murakami nous propose une cartographie de l'âme moderne. Les murs qui entourent la cité ne sont pas seulement des barrières physiques, mais les limites mouvantes de notre perception, les frontières instables entre conscience et inconscient, entre le moi et l'autre.
L'abandon de l'ombre comme prix d'entrée dans la ville pose une question philosophique fondamentale : que sommes-nous prêts à sacrifier pour accéder à une forme de paix intérieure ?
Cette ombre, qui évoque ce que le psychanalyste Carl Jung appelait « l’Ombre » – autrement dit cette part sombre faite de nos traumatismes, de regrets, de culpabilité, et tout ce que l'on refoule et préfère cacher –, représente aussi ce qui nous constitue profondément et ce qui fait de nous des êtres singuliers avec une histoire propre.
En nous en séparant, accédons-nous véritablement à la sérénité ou perdons-nous au contraire notre humanité essentielle ? Murakami se garde bien de trancher cette question, préférant maintenir l'ambiguïté, cette zone grise où se loge la véritable complexité de l'existence humaine.
La solitude, thème récurrent dans l'œuvre murakamienne, acquiert ici une dimension nouvelle. Elle n'est plus synonyme d'isolement ou d'aliénation, mais devient condition d'accès au mystère, porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. Les personnages évoluent dans une forme de solitude partagée, comme si chacun habitait sa propre dimension tout en croisant occasionnellement celle des autres. Cette vision résonne particulièrement dans notre époque hyperconnectée où la proximité physique n'empêche pas l'éloignement existentiel, où nous pouvons être entourés et pourtant profondément seuls.
Symphonie des références
La musique irrigue le roman comme un fleuve souterrain, créant des passerelles invisibles entre les mondes. Jazz, classique, pop – les références musicales ne sont pas de simples ornements culturels mais constituent le langage secret qui relie les dimensions. Chaque morceau évoqué devient une clé, un sésame possible entre les réalités parallèles. Cette utilisation de la musique comme pont narratif rappelle que certaines vérités ne peuvent s'exprimer que dans l'interstice entre les mots, dans ce silence vibrant qui suit la dernière note.
Au-delà de la musique, c'est tout un réseau de références littéraires et culturelles que tisse Murakami, créant un dialogue intertextuel riche avec ses propres œuvres antérieures mais aussi avec la littérature mondiale. On retrouve des échos d’auteurs majeurs comme Kafka (avec son univers bureaucratique oppressant et absurde), Borges (et ses labyrinthes de pensée métaphysiques avec ses récits en forme de casse-tête qui jouent avec la réalité et le temps) ou García Márquez (et son réalisme magique). Murakami s’en inspire, mais les transpose dans un cadre résolument japonais, créant cette hybridité culturelle si caractéristique.
Forces et faiblesses d'une œuvre-somme
La Cité aux murs incertains est une œuvre-somme qui synthétise magistralement les thèmes chers à l'auteur tout en les approfondissant. L'atmosphère onirique et poétique, cette capacité unique à construire un univers envoûtant à la frontière entre rêve et réalité, atteint ici des sommets de maîtrise. La plume de Murakami, dans la traduction française d'Hélène Morita, conserve cette fluidité hypnotique, cette simplicité apparente qui dissimule une profondeur vertigineuse.
Cependant, l'impression de déjà-vu est indéniable pour les lecteurs familiers de l'œuvre murakamienne. Les thèmes, les motifs, parfois même les situations semblent recyclés, comme si l'auteur tournait en rond dans son propre labyrinthe imaginaire : la quête de l'amour de jeunesse perdu rappelle inévitablement Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. La ressemblance avec La Fin des temps est particulièrement troublante, au point qu'on peut se demander si cette nouvelle version apporte véritablement quelque chose de substantiel à la vision originelle.
La longueur du roman et son rythme contemplatif peuvent également lasser. La première partie notamment, avec ses lentes circonvolutions, ses descriptions minutieuses du quotidien, teste la patience du lecteur à de trop nombreuses reprises. Certains passages semblent s'étirer sans nécessité narrative évidente, comme si l'auteur se complaisait dans sa propre rêverie au détriment de la dynamique du récit.
Testament ou un nouveau départ ?
À 74 ans, Murakami offre-t-il son testament littéraire ? La question agite ses lecteurs depuis la parution du roman au Japon. D'un côté, l'œuvre porte indéniablement les marques d'un bilan, d'un retour réflexif sur les obsessions d'une vie entière d'écriture. La tonalité mélancolique, la méditation sur le temps qui passe, sur ce qui reste quand on a tout oublié, suggèrent un auteur en dialogue avec sa propre finitude.
D'un autre côté, le roman témoigne d'une vitalité créatrice intacte, d'une capacité d'émerveillement et d'invention qui contredit l'idée d'un épuisement. Les passages les plus réussis – notamment les séquences dans la bibliothèque où travaille le protagoniste après son retour du monde parallèle – montrent un Murakami au sommet de son art, capable de transformer le quotidien le plus banal en expérience métaphysique.
L'art d'habiter l'incertitude
La Cité aux murs incertains n'est pas un roman de consommation rapide. C'est une œuvre exigeante qui demande du temps, de la patience, une forme d'abandon à son rythme particulier. Les amateurs de résolutions claires, d'intrigues bouclées, de réponses définitives risquent la frustration. Murakami ne cherche pas à résoudre les mystères qu'il pose mais nous invite plutôt à cohabiter avec eux, à accepter que certaines questions fondamentales de l'existence n'ont pas de réponses univoques.
Pour les inconditionnels de l'auteur japonais, ce roman s'impose sans aucun doute malgré ses imperfections comme une pièce essentielle du puzzle murakamien, une variation profonde et méditée sur les thèmes qui constituent le cœur de son œuvre. Pour les néophytes, l'entrée pourrait s'avérer ardue. Pour découvrir l'auteur, nous conseillons plutôt de débuter par des œuvres plus accessibles comme Kafka sur le rivage et surtout 1Q84. Même pour les lecteurs qui découvriraient Murakami avec ce livre, certaines scènes frappent par leur puissance visuelle et émotionnelle, comme la bibliothèque aux allures de sanctuaire ou la mystérieuse disparition du premier amour.
Dans un monde obsédé par la vitesse, l'efficacité et la transparence, cette célébration de la lenteur, de l'ambiguïté et du mystère apparaît comme un acte de résistance poétique. Murakami nous rappelle que la littérature n'est pas seulement divertissement ou information, mais expérience transformatrice, voyage intérieur qui modifie subtilement notre rapport au monde.
En refermant ce pavé de 700 pages, on émerge comme après une longue traversée dans un territoire de brume et inexploré, d'avoir touché du doigt quelque chose d'essentiel et d'insaisissable à la fois – comme le yūgen japonais, cette beauté mystérieuse qu’on ne peut jamais saisir pleinement.
Les murs incertains du titre deviennent métaphore de notre propre condition. Nous vivons entourés de frontières mouvantes, entre veille et sommeil, souvenir et oubli, solitude et communion. L'art de Murakami consiste à nous apprendre non pas à abattre ces murs, mais à y trouver une forme paradoxale de liberté comme dans un jardin zen où le vide importe autant que la pierre. Danser avec l’incertitude, c’est peut-être la plus leçon de ce roman.
-

Le retour de l'auteur japonais le plus lu en France.
Le grand retour du maître Murakami pour un roman éblouissant, dans la lignée de ses grandes œuvres – Kafka sur le rivage ou 1Q84 – et sept ans après son dernier roman – Le Meurtre du commandeur.
Tu dis : " La Cité est entourée de hauts murs et il est très difficile d'y pénétrer. Mais encore plus difficile d'en sortir.
- Comment pourrais-je y entrer, alors ?
- Il suffit que tu le désires "
La jeune fille a parlé de la Cité à son amoureux. Elle lui a dit qu'il ne pourrait s'y rendre que s'il voulait connaître son vrai moi. Et puis la jeune fille a disparu. Alors l'amoureux est parti à sa recherche dans la Cité. Comme tous les habitants, il a perdu son ombre. Il est devenu liseur de rêves dans une bibliothèque. Il n'a pas trouvé la jeune fille. Mais il n'a jamais cessé de la chercher... Avec son nouveau roman si attendu, le Maître nous livre une œuvre empreinte d'une poésie sublime, une histoire d'amour mélancolique entre deux êtres en quête d'absolu, une ode aux livres et à leurs gardiens, une parabole puissante sur l'étrangeté de notre époque.
Traduit du japonais par Hélène Morita.
Un nouveau roman dans la lignée des grands succès d'Haruki Murakami, Kafka sur le rivage, 1Q84,La Course au mouton sauvage, Au sud de la frontière à l'ouest du soleil, Le Meurtre du commandeur, Des hommes sans femmes, L'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, Abandonner un chat, Première personne du singulier ou encore La Ballade de l'impossible.


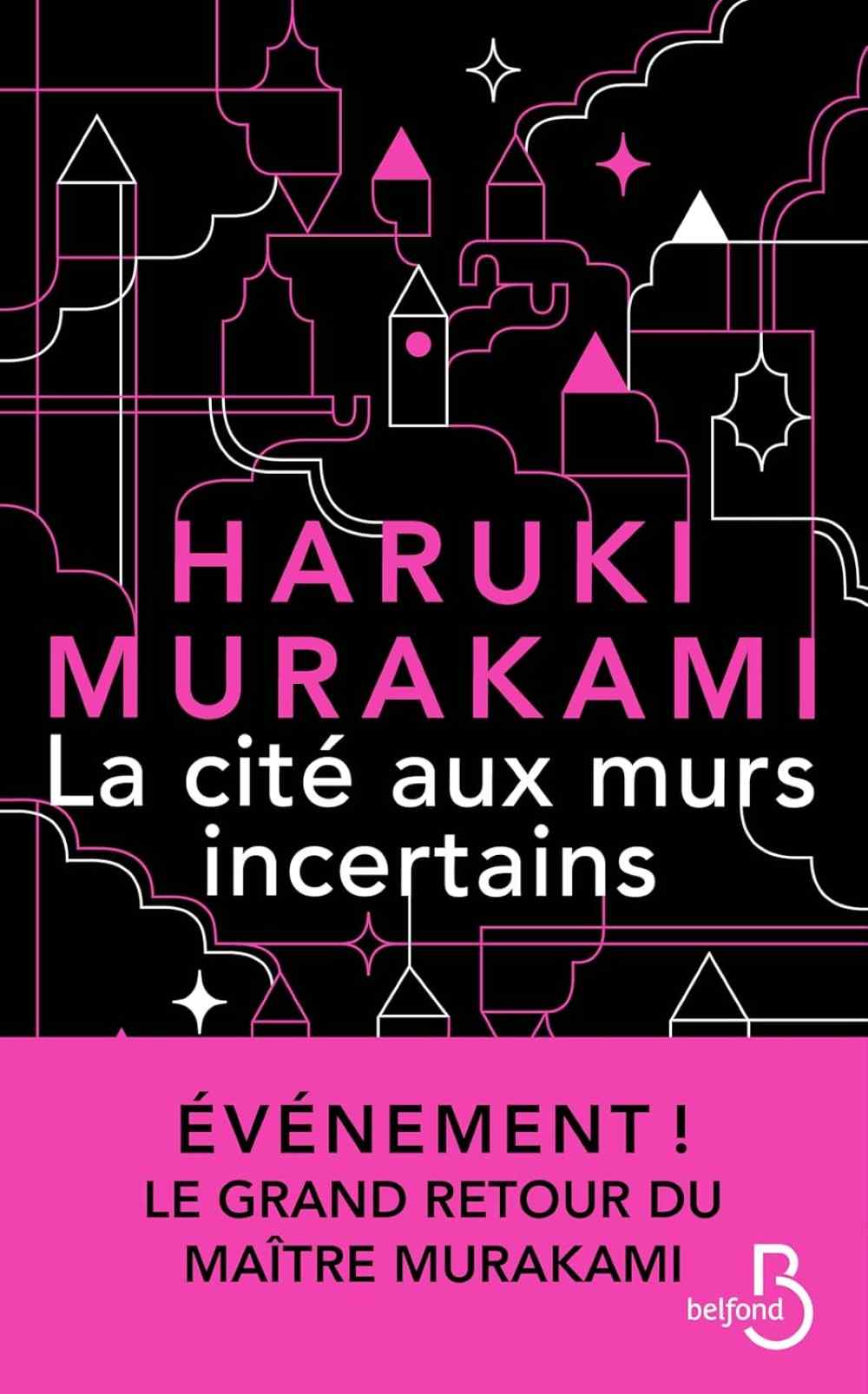




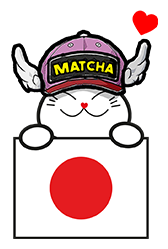
Participez
Ajoutez-en un pour lancer la conversation.
Connexion
Inscription